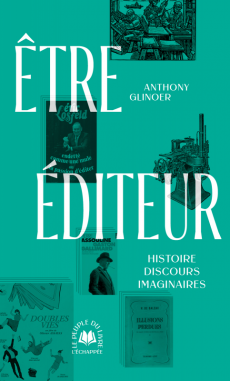« L’Homme-Livre et les "gens du livre" »
Recension de Être éditeur d'Anthony Glinoer par Le Phénix dans Agora Vox.
Si la multiplicité des maisons d’édition et des titres incitent à penser que le livre est une « valeur sûre », l’avenir demeure illisible pour les acteurs du secteur. L’édition, sans cesse remise sur le métier, recombine autant ses chiffres que ses lettres dans un art de l’équilibre qui tient autant du politique et de la « raison financière » que de l’amour de la littérature. Sociologue du littéraire et historien de l’édition, Anthony Glinoer s’attache à l’émergence de « l’être éditeur » et à sa permanence dans un monde en « réinitialisation » constante, secoué par les turbulences de la numérisation à marche forcée comme par la « concentration du capital ».
Les grands Anciens savaient, depuis Platon au moins, que les idées, pour circuler, se devaient d’être livrées, diffusées et exposées. En latin, « edere » signifiait « mettre au jour » et « publicare » se traduit par « livrer au public ». Aussi, Platon, Pline ou Virgile faisaient-ils commerce et pesée de leurs idées dans une forme nommée « livre », en ses déclinaisons : il fallait que leur pensée faite parole s’imprime pour s’adresser à un public.
Leurs livres faits main nouent un dialogue ininterrompu avec des générations de lecteurs livrés à eux-mêmes dans le ressassement des interrogations fondamentales jusqu’à nos jours.
Aujourd’hui, il est entendu qu’« éditer » signifie prendre la « responsabilité juridique, économique et symbolique de la publication d’un livre ou d’un périodique » en pleine tourmente algorithmique et réformatrice. Pour qu’un livre voie le jour, constante Anthony Glinoer, « il faut du papier et des bateaux pour le transporter, des presses, du capital, des comptables, de l’acier pour les machines, des reliures et des relieurs, des graphistes, des banques, des prix littéraires, des clubs du livre, des bibliothèques, des fournisseurs internet, des lecteurs, des relecteurs, des écoles, des associations, etc. »
Les livres se font par les hommes et à travers une foule d’intermédiaires entre l’auteur et le lecteur– à commencer par l’éditeur-patron. Ce dernier, pour prestigieuse que soit sa situation, n’en doit pas moins rester à l’équilibre pour assurer la pérennité de son entreprise et l’inscrire dans l’histoire voire le rayonnement d’une « civilisation ».
Parce que « vendre ou faire vendre des livres » est une activité aussi périlleuse que prestigieuse, l’éditeur doit savoir refuser la plupart des propositions et sollicitations qui lui sont faites sans répit : « Notre métier ? C’est d’abord le courage de refuser » soulignait Bernard Grasset (1881-1955) dans La Chose littéraire (Gallimard, 1929) (...).
Pour lire la suite : www.agoravox.fr/tribune-libre/article/l-homme-livre-et-les-gens-du-livre-258080